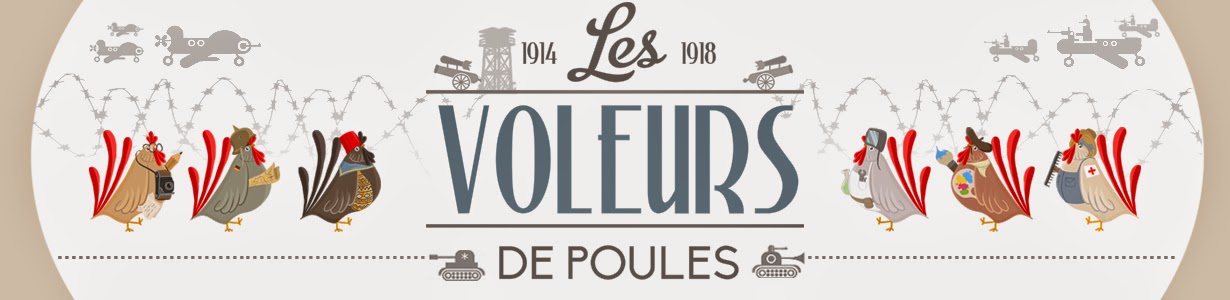|
| Rouge Brun/Rouge Jaune Etudes murales - 1928 |
La guerre fut pour le plasticien allemand Oskar Schlemmer, engagé volontaire en 1914, une expérience tragique qu’il parvint, comme bien d’autres, à enfouir au plus profond de lui-même. La force de ses écrits théoriques, volontairement décontextualisés, agiront longtemps comme un camouflage militaire, lui permettant de bâtir son œuvre dans l’intégrité de sa propre recherche : celle d’un « art total » (et non totalitaire) en résonnance avec les «avant-gardes » artistiques de l’abstraction géométrique, du futurisme, du dadaïsme et du constructivisme.
Ce fut aussi la guerre qui engendra cet «homme nouveau » mis au monde par le Bauhaus dont il fut, avec Walter Gropius, l’un des principaux architectes. Blessé à la jambe, puis au bras, ayant participé aux combats près de Verdun, de Lille et sur le front de l’Est, Oskar Schlemmer saisit en décembre 1916 l’occasion d’une fête de charité, donnée à Stuttgart, en faveur de son régiment pour mettre en scène la première esquisse de son célèbre «Ballet triadique». A la signature de l’armistice, il se consacre à sa chorégraphie, concevant des costumes de plus en plus ambitieux, physiquement éprouvants pour le danseur, le reliant sans qu’il le sache à l'expérience traumatique des tranchées. Le non-dit de la défiguration, de la mutilation et de la prothèse, apparaît, sans crier gare ! «Le ballet triadique, écrit-il, est quelquefois qualifié par erreur de ballet mécanique. Mais il ne l’est absolument pas, dans la mesure où les danseurs sont toujours bien des hommes, qu’ils ont une âme qui ne peut leur être dérobée par un costume plus ou moins rigide.». Trois actes, trois danseurs, trois humeurs «car, écrit-il, Schlemmer, le nombre trois est un nombre extrêmement important et dominant, où le moi (… ) tout comme la dualité́ sont dépassés. Là (à trois) commence le collectif!» qui déterminera la fonction sociale de son théâtre[1].
 |
| Personnage de "Résumé" Ballet triadique |
Les contraintes physiques surprenantes des costumes de Schlemmer régissent l’écriture du ballet, réorganisent les corps et limitent leurs mouvements. De tous les personnages du ballet, le soldat blessé Schlemmer choisira d'interpréter «Résumé Premier». Qu’importe qu’il soit armé d’une couteau et d’un bâton, il est définitivement impuissant avec cette grande patte blanche conique qu’il ne peut (plus) plier. Avec «Résumé Premier», le danseur n’est plus qu’un boiteux, un unijambiste. «Il faut partir de la position du corps, de sa présence, de la position debout, de la marche et, en dernier lieu seulement, du saut et de la danse ! Car si faire un pas est un évènement prodigieux, lever une main ou remuer un doigt ne l’est pas moins.» écrira O. Schlemmer dans son « Journal ».
L’uniforme crée le soldat en imposant à son corps une attitude et des gestes qui ne lui sont pas naturels; de même «le danseur revêt moins les costumes que les costumes ne le revêtent ; il les porte moins que les costumes ne le portent» (ibid.). Avec le personnage au torse ovoïde, «Sphère», l’extrême violence de la mutilation apparaît : on ne sait si ses membres ont été coupés ou tirés vers l’arrière. Les « danseurs jumeaux », avec leurs disques menaçants se déplacent l’un vers l'autre, se "découpent" pour se confondre. Il en va ainsi de chacun d’entre eux, la meurtrissure des obus se dissimule sous le costume. Rejeté par les nazis, Schlemmer s’éteindra en 1943 des suites de ses blessures de guerre.
Article rédigé avec Christophe, Elodie et Lena (dans le cadre d'une résidence d'écriture et de recherches à Stuttgart )
La Vidéo : Reconstitution du "Ballet triadique" par les chorégraphes Margarete Hasting, Franz Schömbs et Georg Verden, sur les conseils de Tut Schlemmer, veuve du créateur. Distribution : Edith Demharter, Ralph Smolik, Hannes Winkler.
Propositions pédagogiques pour aller plus loin:
En vous servant de la vidéo, rechercher dans chacun des personnages les "meurtrissures" de la guerre.
Effectuer un travail de recherche sur le mouvement artistique appelé "Bauhaus".
Atelier de danse axé sur l'étude du "mouvement" sur la musique originale du ballet composée par le violoniste Paul Hindemith dont le père avait été tué au cours de la guerre et celle entendue sur la vidéo que l'on doit au "jazzman" allemand Erich Ferstl. (Nous contacter)
___________________________________________________________________________________________________________________________
[1] Le caractère trinitaire de la création est confirmé par l’utilisation des trois couleurs primaires (bleu, rouge jaune) et des trois formes fondamentales que sont le cercle, le carré et le triangle (ou bien encore la sphère, le cube et la pyramide).