 |
| Appareil photographique allemand de marque Flieger à focale de 50 (1918) |
Dès la fin de l’été 1914, les différents commandements
militaires voulurent connaître le plus précisément possible la position des
lignes ennemies. Les missions de reconnaissance aérienne s’imposèrent et les
aviateurs se firent photographes.
 |
| Photographe allemand en action |
La qualité médiocre des photographies obligea les industriels à développer de nouveaux modèles. Le britannique Thornton-Pickard et l’allemand Flieger mirent au point de nouvelles focales de 50/70 mm et des téléobjectifs plus puissants qui permirent, à haute altitude, de percer les camouflages de l’infanterie. Plus tard, les italiens construiront des avions monospace capables, en survolant les montagnes tyroliennes, de prendre des clichés à plus de 3000 mètres grâce à des caméras fixes. En décryptant les camouflages utilisés par l’armée adverse, la photographie aérienne va susciter une créativité sans précédent dans l’art de la dissimulation. L’ennemi est là, tapi dans les recoins et les plis de la terre. En 1917, dans l’espoir d’échapper aux bombardements nocturnes allemands, l’armée française ira jusqu’à inventer, dans la campagne, un faux Paris lumineux, frère jumeau du vrai Paris plongé, lui, dans l’obscurité la plus complète. Une section de « camoufleurs » est créée mobilisant de nombreux peintres parmi lesquels André Mare. Celui-ci appliquera les principes du mouvement cubiste de la dislocation des formes en juxtaposant des bandes de couleurs sur les pièces d’artillerie. Ainsi parvint-il, face au photographe, à en effacer les contours pour mieux les fondre dans le paysage. Le photographe voyait un arbre mort, et c’était déjà un canon ! A croire que sur terre comme au ciel, « il n’existe pas de belle surface qui n’ait une profondeur effrayante » (Friedrich Nietzsche).
Article rédigé avec Christophe, Elodie et Lena (dans le cadre d'une résidence d'écriture et de recherches à Stuttgart )
La Vidéo : Pilotes allemands se préparant à une mission de reconnaissance aérienne à 1000 mètres d'altitude sur un biplan Rumpler. Photographe en action, survol de Verdun et des combats. Une séquence de la bataille de la Somme qui montre la troupe allemande fuyant ses tranchées prises sous un feu intense de l'artillerie britannique (Attention : erreur sur la diapositive qui indique à tort une avancée des troupes). Date de tournage : 1916.
Propositions pédagogiques :
Ateliers d’écriture sur l’enchevêtrement des traces humaines et non humaines à partir de photographies aériennes (collèges et lycées). Nous contacter !
Atelier de camouflage (toutes classes). Nous contacter !
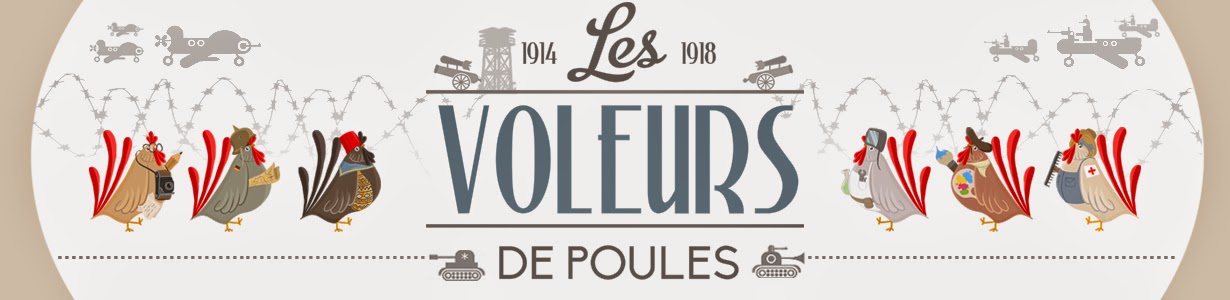
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire